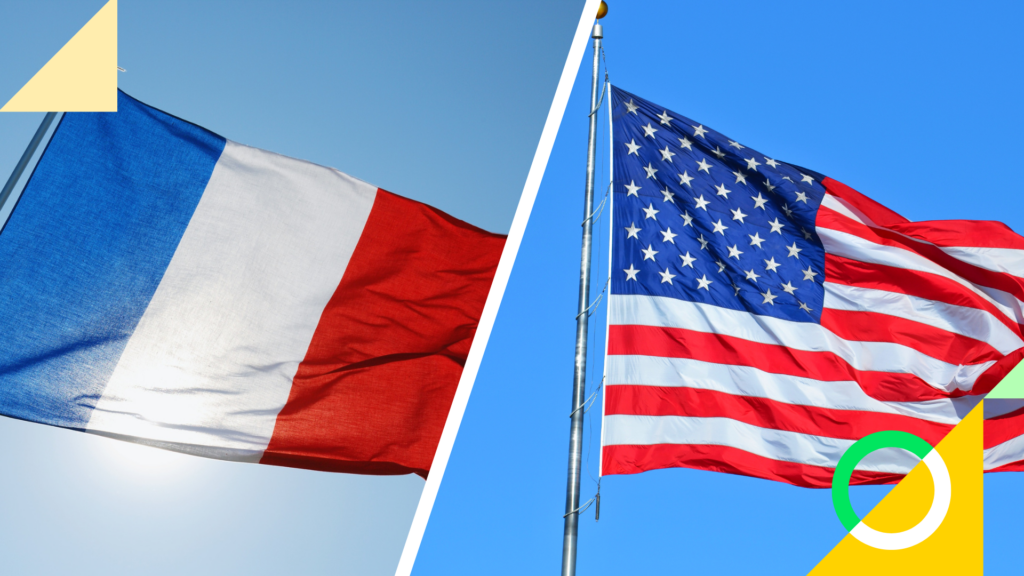Le retrait des politiques de DEI (Diversité, Équité et Inclusion) par l’administration Trump a amené de nombreuses entreprises américaines à diminuer leurs engagements en matière de DEI et à modifier leurs stratégies de communication correspondantes. Cette évolution a des répercussions mondiales, les multinationales adaptant leurs approches pour s’aligner tant sur les politiques américaines que sur l’intérêt croissant pour la DEI dans d’autres régions comme l’Europe et l’Asie, où ces initiatives demeurent prioritaires.
Notre récent rapport Brand Influence Rank analyse comment 50 des marques mondiales les plus influentes réajustent leurs initiatives de politique de diversité et inclusion,et précisément comment les médias influencent la perception de ces initiatives.
Les politiques de DEI des entreprises française sont un sujet d’actualité brûlant du fait des décisions de l’administration Trump: Les médias français (Les Echos) révèlent qu’une lettre a été envoyée par l’ambassade des États-Unis à Paris à plusieurs dizaines d’entreprises françaises, leur demandant d’abandonner leurs politiques de diversité, équité et inclusion (DEI) pour maintenir l’accès aux appels d’offres du gouvernement fédéral américain. Cette exigence, liée à une politique anti-DEI de l’administration Trump, a suscité une couverture médiatique importante et des débats animés sur les réseaux sociaux, reflétant des tensions diplomatiques et idéologiques.
Plusieurs entreprises françaises ont reçu une lettre de l’ambassade des États-Unis, leur demandant d’abandonner leurs politiques de diversité, équité et inclusion (DEI), sous peine de perdre l’accès aux contrats fédéraux.
La couverture médiatique française, notamment Le Monde et Le Figaro, confirme l’incident, le liant à une politique anti-DEI de l’administration Trump.
Les réactions sur les réseaux sociaux montrent une indignation généralisée, avec des utilisateurs critiquant cette ingérence comme un « chantage extraterritorial ».
Contexte et couverture médiatique
Le 28 mars 2025, l’ambassade des États-Unis à Paris a envoyé une lettre à plusieurs dizaines d’entreprises françaises, leur demandant de certifier, dans un délai de 5 jours, qu’elles ne mettaient pas en œuvre de tels programmes, sous peine de perdre leurs contrats, conformément à un décret signé par Donald Trump le 21 janvier 2025.
Selon Le Monde, cette mesure s’applique à tous les fournisseurs du gouvernement américain, peu importe leur localisation ou nationalité, affectant même des entreprises françaises sans opérations aux États-Unis, ce qui constitue un élargissement inattendu de l’impact. Des entreprises comme Saint-Gobain, Axa et Kering, n’ayant pas de contrats fédéraux, n’ont pas été concernées, mais d’autres, comme des cabinets d’avocats, l’ont été, selon Le Point.
La couverture médiatique, débutant le 28 mars 2025 avec la révélation par Les Echos, a été rapide et extensive, avec des articles dans Le Figaro, France TV Info, et TF1 Info. Ces reportages confirment l’envoi de la lettre et détaillent les réactions, notamment la dénonciation par le ministère du Commerce extérieur comme une « ingérence inacceptable », et par Patrick Martin, président du Medef, comme un geste « inadmissible » traduisant une dérive du président américain, selon 20 Minutes. Les médias soulignent également que certaines entreprises ont choisi de ne pas signer la certification, face à des accusations d’extraterritorialité.

Reuters et Les Échos insistent sur l’extraterritorialité de cette mesure, qui marque une nouvelle phase dans la « guerre contre le woke » menée par l’administration Trump
Des médias tels que Le Monde, BFMTV et Le Figaro soulignent la stupeur qu’a provoquée cette démarche dans les milieux économiques et politiques français, insistant sur l’ingérence jugée inacceptable dans les politiques d’inclusion nationales
Plusieurs articles rappellent que ce courrier intervient dans un contexte de tensions commerciales exacerbées, avec des menaces de droits de douane injustifiés et des mesures réciproques envisagées par l’Union européenne.
Actu.fr et MSN insistent sur le fait que le courrier intervient alors que la France ne pratique pas – ou interdit certaines formes de – discrimination positive, ce qui amène à constater une mise en avant des divergences culturelles et réglementaires entre les deux pays 2.
Valeurs Actuelles et Le Point mettent en exergue le ton polémique de cette initiative américaine, la qualifiant de tentative de « soft power » visant à imposer aux entreprises françaises une vision du monde qui ne correspond pas aux valeurs françaises en matière d’inclusion et de respect de la souveraineté économiqu
Réactions officielles
Le ministre français de l’Économie, Éric Lombard, et le président du Medef, Patrick Martin, ont dénoncé cette démarche comme une « ingérence inacceptable », reflétant des valeurs américaines non partagées en France. Le ministère du Commerce extérieur a lui dénoncé ces « ingérences américaines » et affirmé que « la France et l’Europe défendront leurs entreprises, leurs consommateurs, mais aussi leurs valeurs ».
La CPME a dénoncé une atteinte à la souveraineté française, tandis que la CGT a appelé les entreprises à ne pas céder à ces pressions.
Sur les médias sociaux
Sur les réseaux sociaux, les réactions, observées entre le 28 et le 31 mars 2025, montrent une indignation généralisée. Des utilisateurs ont exprimé leur colère, qualifiant l’action de « chantage extraterritorial », tandis que d’autres s’interrogent sur le manque de discussion autour de cette « exigence outrageante ». D’autres, ont critiqué l’autorité perçue des États-Unis, demandant si les « trumpistes » se croyaient « rois du monde ». Les comptes médiatiques, comme @franceinfo et @France24_fr, ont relayé les critiques du Medef, renforçant le sentiment d’opposition. Malgré des recherches, peu de posts soutenant explicitement la politique anti-DEI ont été trouvés, suggérant une prédominance des critiques. Toutefois, quelques messages ont loué la politique américaine en espérant la fin du “wokisme” en France.
Débats sur la pertinence du concept DEI
Une autre partie des discussions se focalise sur le débat de fond concernant la discrimination positive. Certains internautes, attachés à une vision progressiste de l’inclusion, défendent les politiques DEI en soulignant leur nécessité dans une société en quête de justice et de diversité. À l’inverse, d’autres prônent une approche purement méritocratique, rejoignant en cela la logique du décret américain.
Critiques de l’extraterritorialité
De nombreux utilisateurs dénoncent le fait que les États-Unis cherchent à imposer leurs propres normes et réglementations – issues de politiques anti-DEI mises en œuvre depuis le retour de Trump – à des sociétés étrangères. On voit émerger des hashtags tels que #StopIngérences ou #SouverainetéDEI, symbolisant l’indignation face à ce qu’ils perçoivent comme une empiétement sur la souveraineté française et européenne.
D’autres acteurs, notamment des dirigeants d’entreprises et des juristes, débattent de la légalité et de l’applicabilité de ce décret sur le sol français, soulignant que le cadre juridique français — qui limite notamment la collecte de données ethniques et encadre strictement la discrimination positive — est en contradiction avec ce type de mesure.
Questionnement sur l’impact pour les entreprises
Il est également question, sur X, des conséquences pratiques pour les entreprises françaises qui se retrouvent face à ce dilemme : renoncer à des politiques d’inclusion longtemps intégrées dans leur modèle ou risquer de perdre des contrats lucratifs avec l’État fédéral américain.
Enfin, des voix sur X rappellent que plusieurs grandes entreprises françaises, fières de leur modèle d’inclusion (dans des secteurs comme le luxe, les télécoms ou l’énergie), n’ont pas l’intention de céder à cette pression, affirmant ainsi leur attachement aux valeurs de diversité et d’égalité.

Dans les médias étrangers
La nouvelle a été couverte par les médias étrangers. Des médias internationaux, tels que le New York Times, AP News, DW (Deutsche Welle et le Financial Times, ont rapporté cette histoire. Ces articles soulignent les tensions diplomatiques, la France dénonçant cette mesure comme une « ingérence inacceptable », et notent que certaines entreprises françaises n’ayant pas d’activités aux États-Unis ont également été touchées, ce qui est un détail inattendu.
La couverture semble se concentrer sur la controverse entourant le décret du président Trump interdisant les programmes de DEI et son application extraterritoriale, avec des réactions de responsables français comme la ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, affirmant que de nombreuses entreprises françaises n’envisagent pas de changer leurs politiques, soulignant que la France ne permettra pas d’empêcher ses entreprises de promouvoir le progrès social, selon AP News.
Les articles fournissent des comptes rendus détaillés du contenu de la lettre, de la réaction du gouvernement français et des implications plus larges pour les relations transatlantiques. Par exemple, Le New York Times a fait état du délai de cinq jours pour se conformer à la lettre, tandis que AP News a souligné la déclaration de la ministre française Aurore Bergé selon laquelle de nombreuses entreprises n’ont pas l’intention de modifier leurs politiques, soulignant ainsi l’engagement de la France en faveur du progrès social.
D’autres articles comme ceux de DW et Financial Times l’analysent comme faisant partie de la campagne idéologique plus large de Trump. La couverture comprend également des réactions d’autres pays européens, avec POLITICO rapportant la critique du vice-premier ministre belge Jan Jambon, suggérant une réaction européenne plus large. L’inclusion inattendue d’entreprises n’ayant pas d’activités aux États-Unis, comme le note CNBC, pourrait conduire à de nouveaux débats sur la compétence extraterritoriale, un sujet susceptible de trouver un écho dans les milieux juridiques et commerciaux internationaux.
Cette affaire met en lumière un conflit entre les priorités politiques américaines et les pratiques des entreprises françaises, où les DEI, bien que moins développés qu’aux États-Unis, incluent des quotas légaux comme 40 % de femmes dans les conseils pour les grandes entreprises. L’impact potentiel sur les relations franco-américaines est notable, avec des accusations d’ingérence pouvant mener à une crise diplomatique, comme le suggèrent certains medias. Sur les réseaux sociaux les discussions amplifient l’indignation, mais restent fragmentées, sans consensus clair, reflétant des divisions idéologiques sur la souveraineté et la diversité.
Pour poursuivre la réflexion, téléchargez notre rapport sur les marques les plus influentes en matière de DEI et développement durable dans le monde :